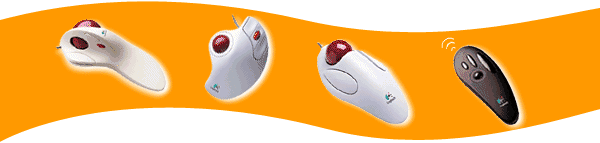Alphabet Braille
NB. Les cellules Braille représentées sont d'une taille deux fois supérieur à la réalitéLes gros points représentent les points en relief de la cellule Braille
Les petits points représentent les emplacements laissés vides
Lettres et signes de ponctuation
Chiffres et signes mathématiques
Toutefois ce système présente un certain nombre de difficultés, ou pour le moins de contraintes.
- Du fait de la taille de chaque cellule Braille, "le volume des productions est en moyenne 30 à 50 fois supérieur à celui des imprimés ordinaires (2) ." Le petit Larousse occupe en Braille une armoire ou une bibliothèque pleine, à lui tout seul. La production, l'accès et le transport de ce type de document s'en voit donc compliqué d'autant. Pour remédier à cela, il a été créé un Braille abrégé qui permet de nombreuses contraction de mots, de suffixes et de préfixes. Ainsi, pour l'impression du français en Braille abrégé, on parvient à une économie de place de l'ordre de 40 % (3) par rapport au Braille classique (appelé le Braille intégral).
- Le problème se retrouve en ce qui concerne la vitesse de lecture. Le Braille est lu lettre à lettre, alors que visuellement le mot est reconnu en tant que forme globale. Dans le premier cas, la vitesse moyenne de lecture est de l'ordre de 100 mots par minute. Dans le second elle est d'environ 250 mots par minute. Le recours au Braille abrégé ne permet apparemment pas, en français, un gain très significatif de vitesse de lecture (4) . Celle-ci semble plutôt dépendre de l'âge d'apprentissage et du mode de lecture. Un apprentissage dans l'enfance et une lecture bimanuelle, souvent par une "exploration disjointe simultanée" (5) des deux indexes sur deux passages différents du texte, sont autant de gages de rapidité.
- Enfin, et peut être surtout, le Braille est une technique complexe qui suppose un apprentissage long (tout particulièrement s'il est appris à l'âge adulte), des capacités cognitives et tactiles adaptées ainsi qu'une motivation solide. Cette exigence explique sans doute que le Braille reste peu pratiqué par les déficients visuels et que le niveau moyen de ceux qui l'utilisent demeure faible (6).
L'écriture du Braille est possible soit de manière
automatique (transcription informatique d'un texte en mémoire),
soit manuellement grâce à l'aide d'une tablette ou d'une machine.
- Sur la tablette, le sujet imprime avec un poinçon en creux et en miroir (de droite à gauche), un texte qu'il ne peut relire qu'en retournant sa feuille (pour avoir les points du côté des bosses). Technique qui est utile pour des prises de notes rapides et discrètes, mais complexe au niveau pratique du fait de l'inversion qu'elle suppose.
- L'écriture du Braille à la machine permet d'éviter ces deux difficultés. En effet, les points sont embossés simultanément par- dessous. Le sujet n'a pas d'inversion à réaliser et peut relire ce qu'il vient de taper. La machine permet donc, principalement pour l'enfant, à la fois un apprentissage plus rapide et une réduction importante des erreurs de symétrie de caractère.
Notes :
(1) PHILIP, P. Lire sans voir. Journal
des psychologues 1991 84,46-48
(2)MOUSTY, P. Aperçu de la recherche
sur la lecture du Braille. Communication au 2 ème congrès
européen "Activités physiques adaptées aux handicapés
de la vue." Bruxelles 1992
(3)OLIVIER, S., CAMPBELL, R. Le Braille.
Longueil, Québec, Institut Nazareth et Louis Braille 1981
(4) Le gain de rapidité de lecture
est estimé comme étant d'environ 10 % selon MOUSTY, P., Op.
Cit., mais il varie selon les langues et les degrés de contraction.
Ainsi en norvégien il est de 18,5 %, si l'on en croit BRUTEIG, J.M.
The reading rates for contracted and uncontracted Braille of Norwegian
adults. Journal of visual impairment and blindness 1987 81, 19-23
(5) MOUSTY, P., Op. Cit
(6) Cf. notamment ; HAMPSHIRE, B. La pratique
du Braille. Presses de l'U.N.E.S.C.O. 1981, et : SCHROEDER, F. Literacy
: The key to opportunity. Journal of visual impairment and blindness 1989
83, 290-293